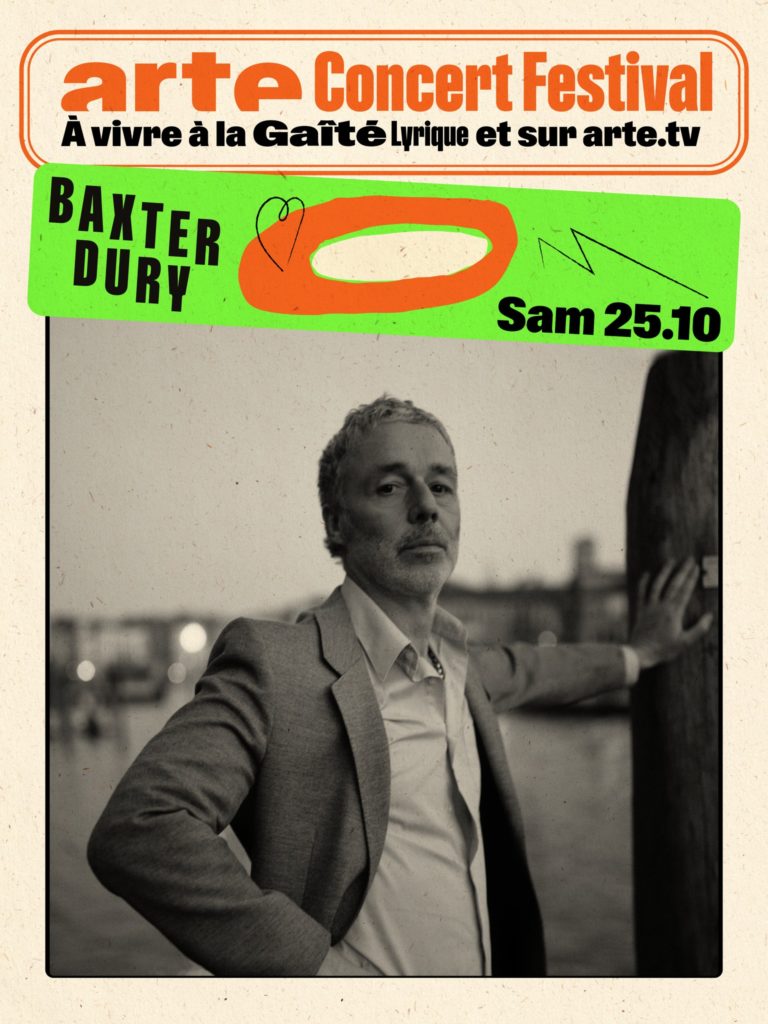Quel grand plaisir que de redécouvrir In The Soup sur grand écran, trente-quatre ans après sa sortie initiale. La comédie dramatique d’Alexandre Rockwell jouit en ce début d’année d’une nouvelle projection dans quelques salles parisiennes à partir du 7 janvier 2026. Une avant-première avait lieu le 6 janvier au Max Linder Panorama en présence du réalisateur et d’Arnaud Desplechin. Un joyau retrouvé grâce au travail de restauration de la jeune maison de distribution Contre-Jour. Récit.
UN FILM DI ALDOLFO ROLLO
Il y a des films que l’on découvre par hasard, au détour d’une recherche internet pour certains, au fond d’un (des derniers) vidéoclub(s) pour d’autres. C’est le cas pour moi avec In The Soup, découvert à 16 ans lors d’une phase particulièrement passionnée sur la carrière de Steve Buscemi. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais sachez que c’était une période fantastique dans ma vie de jeune cinéphile. In The Soup, en quelques mots, c’est l’histoire d’un rêveur, d’un créateur, Aldolpho Rollo (Steve Buscemi). Auteur d’un scénario alambiqué et incompréhensible de 500 pages, il est à la recherche d’un producteur tout en s’imaginant une idylle avec sa voisine Angelica (Jennifer Beals). Et c’est à peu près là que Joe (Seymour Cassel) débarque. Malfrat excentrique, toujours à courir, déroutant et jamais là où on l’attend (par exemple, sur ton oreiller quand tu dors, derrière ta fenêtre barricadée et serrure changée). « On m’appelait Spiderman quand j’étais petit parce que je grimpais partout, » dira-t-il après avoir encore réussi à s’introduire chez Aldolfo.
MANIC PIXIE DREAM GANGSTER
Ne passons pas par quatre chemins : tout le monde est fantastique dans le film. Ce qui fait aussi la richesse de ce film, c’est son florilège de personnages secondaires. Jim Jarmusch et Carol Kane jouent les producteur.rices fashion d’une émission La Vérité Nue, où l’on partage toutes ses vérités… nu.e. Stanley Tucci joue Grégoire, un français au bord de la crise de nerfs. Will Patton, le frère hémophile et sans cœur de Joe. Rockets Redglare et Steven Randazzo en propriétaire d’immeuble impitoyables et chantants…

Éternel acteur secondaire pour beaucoup, la carrière de Steve Buscemi au début des années 90 prouve plutôt le contraire. Acteur à nuances (avec un grand s), tantôt comique, tantôt tragique, parfois pathétique, jamais ridicule, il incarne l’humanité de ses personnages avec une justesse remarquable. Dans le rôle d’Aldolfo Rollo, il touche autant qu’il fait rire, avec son expression excédée quasi-constante, ses fixations (« Je veux juste faire mon film ») et ce besoin de connexion désespérée qui déborde de son regard en biais. C’est Joe qui lui ouvrira ces portes, du moins on pense, on ne sait plus à force. « Joe a cette capacité de te faire sentir spécial, même si tu sais qu’il te mène en bateau et ce soir-là je l’aurais suivi n’importe où, il était magique. T’avais juste à profiter du voyage. » dit en voix off Aldolfo sur une scène de danse dans un parking.
Seymour Cassel y est flamboyant, comme à son habitude. Drôle, un peu flippant, ce rire terrible, gras comme leitmotiv de ses frasques. Il secoue Aldolfo de sa torpeur, le sort de sa tête et le pousse à lâcher ses grandes références (Nietzsche, Tarkovsky, Renoir et Godard) et le replacer au cœur de la vie. « Lâche cette merde, fais un film romantique. Un ‘Je t’aime’ sonne toujours neuf à mes oreilles. » Parce qu’à grands coups de farces et d’excès, le personnage de Joe offre un plaidoyer aux jeunes artistes : arrêtez le sensationnel pour le sensationnel, trouvez l’or dans les petites choses. Joe n’est pas un mentor ni un escroc à part entière : il est une force gravitationnelle, un moteur qui attire, désoriente, propulse, quitte à précipiter tout le monde dans le décor.
In The SOup : Témoignage de la downtown scene
In The Soup avait déjà à l’époque de mes 16 ans cette qualité d’ovni du cinéma à mes yeux. À la croisée d’un Jarmusch et d’un Cassavetes : la Downtown Scene de New York en très très arrière-plan, un noir et blanc brillant, argenté, velouté, des personnages désœuvrés, poussés par un désir plus grand qu’eux ; celui de créer. Alexandre Rockwell le dira d’ailleurs lors du débat suivant la projection, il s’est inspiré de sa propre expérience en tant que cinéaste débutant pour concevoir ce film. « Moi aussi, j’ai ramené ces gangsters chez ma mère! » plaisante-t-il. Ce rapport instinctif au cinéma (aimer Tarkovsky comme Walter Hill, sans hiérarchie, sans révérence figée) traverse tout le film et irrigue le discours de Rockwell, qui revendique un amour du cinéma sans échelle de valeur.
Rockwell appartient à cette génération de cinéastes new-yorkais des années 90 avec Jarmusch et d’autres. « On fréquentait les mêmes clubs, buvait tout autant et dansait comme des cons. Ça rapproche. » Malgré ces influences, Rockwell ne tombe jamais dans la pale copie, ni dans la copie tout court. Il ne tombe même jamais vraiment. Le film a cette qualité funambule, en équilibre sur son fil, faisant semblant de tomber pour surprendre sa.on spectateur.rice. À l’image de Joe.
Un bijou à voir et à revoir pour tout.e créateur.rice qui se prend un peu trop la tête.

John Waters, Génie du Sale : Retour sur un cinéaste d’exception
John Waters, avec sa carrière aussi prolifique qu’audacieuse, incarne l’esprit rebelle le plus radical du…
Vivre d’Oliver Hermanus : la vie avant la mort (critique)
Avec le brillant Kazuo Ishiguro aux commandes du scénario, le dernier film d’Oliver Hermanus, Living (ou…