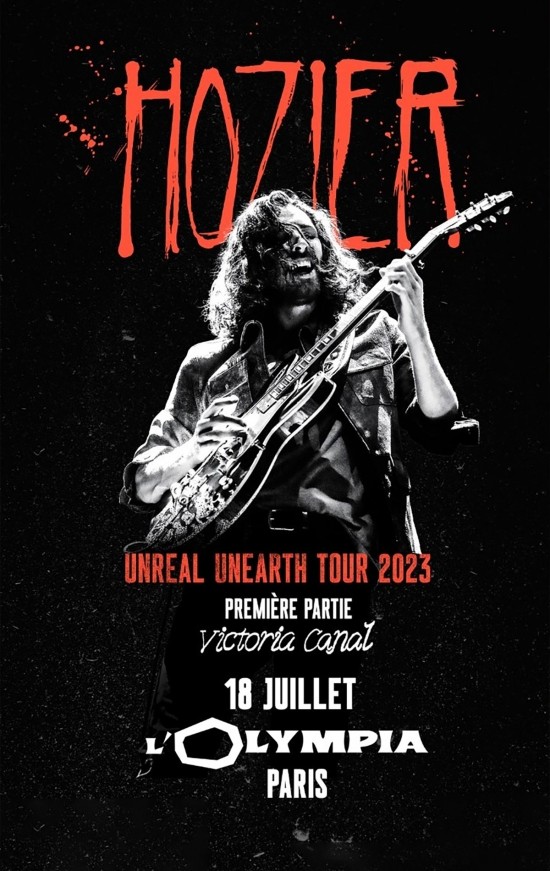Il était attendu le spin off de The Boys. Et c’est normal. La série de super-héro la plus crasseuse, jusqu’au boutiste et décalée du moment a su se fédérer un public d’adeptes d’Homelander et de ses acolytes à la morale douteuse. Trash, souvent gore, toujours drôle, choquante, percutante mais surtout avec une critique au vitriole et d’une justesse impressionnante de la société actuelle, l’original tirée des comics du même nom, avait placé la barre très haut. On espérait donc que sa petite sœur, Gen V, saurait réunir tous ces éléments, les mixer et en tirer une histoire originale. Pari réussi ? On vous parle des trois premiers épisodes dévoilés sur Amazon Prime. (sans spoilers)

Gen V de quoi ça parle ?
Les vies mouvementées de super-héros en devenir dans une école ultra-compétitive gérée par Vought International, où leur résistance physique, leurs hormones et leurs limites sont testées au quotidien. A la clé : les meilleurs contrats pour les meilleures villes.
Gen V, est-ce que c’est bien ?
On prend la même recette mais on change les ingrédients. C’est un peu ainsi que se découvrent les premiers épisodes de cette série. Là où The Boys plaçait un cadre d’empathie et de choc dès ses premières minutes via le personnage de Hughie (Jack Quaid) et de sa bien aimée, Gen V tente de frapper encore plus fort. La scène d’ouverture promet donc son bain de sang (et ceux qui l’ont vue savent qu’il y en a plus que dans le scène du bal de « Carrie au bal du diable ») mais pas seulement. Il permet aussi de placer ses bases : on va parler de super pouvoirs qui ne font pas du bien et on va décaper le wokisme d’image, s’amuser à être féministes pour de vrai mais en explosant ceux et celles qui s’en servent sans conviction et par pure appât financier. C’est donc ainsi que l’on rencontre notre personnage principale : Marie Moreau qui rêve d’être la première femme noire à rejoindre les Sept. Dans The Boys, Ashely Barrett (Colby Minifie), chargée de l’image de Vought que l’on retrouve aussi dans Gen V, explique que « Black Lives Matter » c’est son hashtag préféré. Une réplique coup de poing, pied de nez à toutes les grandes entreprises qui disent se battre pour des causes nobles mais n’en pensent pas un traitre mot. Et la raison pour laquelle on la cite ici, c’est parce qu’elle résume bien le propos que tient cette nouvelle série trois épisodes durant. Stop à l’hypocrisie, on vous voit, on vous juge. Et pour bien vous juger on va clairement en rire. Mieux encore, on va clairement choquer.

Dans cette optique, la série s’offre un crochet par en dénonçant le pink washing. Elle dépeint un.e personnage, Jordan Li (Dereck Luh) qui est à la capacité de changer de sexe à volonté. Iel devient femme puis homme au gré de ses humeurs et besoins. Évidemment, son pouvoir dérange et ne lui permet pas de se fixer au top des podiums. Trop compliqué à comprendre, il déplait en plus au public en Floride. On peut être ouverts, mais quand même pas à se point…
Gen V tourne aussi autour d’un classement. Qui sera le ou la meilleur.e ? Nos jeunes super héros (mais qui ne sont pas du tout des héros), dopés dans leur enfance au composant V (celui qui permet d’avoir des pouvoirs) se disputent la première place. Celle qui permettrait de rejoindre les Sept et l’équipe d’Homelander ou de devenir une star internationale. D’un côté de l’école, il y a celles et ceux qui se destinent à être des justiciers, de l’autre à faire vivre l’entertainement. Télés réalités, films, Danse avec les Stars, shows grandiloquents… voilà les carrières qui leur sont promises. Dans cette équipe , la colloc de Marie Moreau, Emma Shaw (Liz Brodway) apporte l’une des notes les plus attachantes de la série. Elle permet de créer un personnage qui va questionner l’image du corps de la femme, certes, mais surtout la récupération (à vomir) par tous et toutes qui en est faite. De nombreux personnages décidant pour elle de ce qu’elle ressent, de comment elle le gère, de comment elle doit en parler. Tout en prônant de jouer la carte de la sincérité, au cœur des véritables problématiques féminines. Et en la matière les femmes qui lui donnent la réplique sont aussi néfastes que la masculinité toxique. Et c’est tout aussi dérangeant que jubilatoire à regarder scène après scène.
D’autre personnages viennent bien sûr s’ajouter au casting, le super-héro évident, Golden Boy, homme blanc et beau-gosse, dont tout le monde attend beaucoup ( Patrick Schwarzenegger) ou encore son ami Andre Anderson au fort héritage sur les épaules (Chance Perdomo qu’on a grand plaisir à retrouver depuis Les Nouvelles aventures de Sabrina). Le tout est servi avec une bonne dose de suspens et surtout un grand mystère à éclaircir. Et pour le servir les cliffangher vont bon train, écrit comme les grands shows américains savent le faire, dosant l’action et le suspens avec la même précision que les gros blockbusters dont sont les héros Queen Maeve et Starlight …
Du trash, du gore, du fun
Enfin reste l’esprit The Boys, un décalage complet dans le ton, du gore très assumé, des litres d’hémoglobine utilisés pour faire rire et marquer les esprits. Si dans la série d’origine, tout ça va crescendo partant du bien crado pour arriver au très crado, ici et en seulement trois épisodes à ce jour diffusés, les choses partent rapidement dans tous les sens. Une bite géante face à un mini personnage la dispute à des meurtres hyper violents, boyaux, explosions et entrailles en tête de liste. Et toujours utilisés pour servir de gros rires qui feront plaisir aux fans de séries B. Aucun répit n’est laissé au spectateur. On se régale en poussant de petits cris.Pas étonnant donc, de retrouver au générique et à la production le très barré Seth Rogen.
Reste à attendre les 5 prochains épisodes qui promettent de s’en mettre plein les yeux et de patienter sagement jusqu’à la saison 4 de The Boys, qui elle aussi laisse entrevoir son lot de rollercoasters, qu’on espère aussi acerbes et sombres que ceux du parc d’attraction dédié à Queen Maeve, Proud Maeva, ce pink washing dénoncé sans concessions.