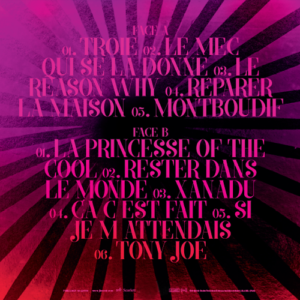Depuis la sortie de son premier album en octobre dernier, Nedelko ne nous lâche pas. Du moins sa musique, qui est l’une de nos révélations préférées de l’année passée. « Rhéologie », son premier album, marque un premier pas déjà extrêmement abouti, et surprend à mesure des écoutes, tant on y trouve un dosage équilibré renforcé par l’accomplissement d’un style diversifié. Une force paisible qui, à travers des textes aiguisés, parvient à nous mordre à plein crocs. Sensible au rap et à la musique en général depuis longtemps, Nedelko, de son vrai prénom Roméo, trifouille d’abord dans son coin, comme beaucoup d’autres avant lui. Sa passion l’amène rapidement à devenir de plus en plus exigeant, technique et productif, jusqu’au jour de la véritable concrétisation avec son adhésion au collectif lyonnais de rap « L’Animalerie », lequel ont rejoint avant lui les talentueux Lucio Bukowski, Robse, Anton Serra… On sait à quel point ce collectif a fait ses preuves par le passé, avec plusieurs albums qui, encore aujourd’hui, résonnent comme de terribles coup de poings (La Plume et le Brise Glace, Colibri, Pense Bête, si ce n’est pour citer qu’eux…). Nedelko fait donc partie de cette jeune scène montante du rap, qui explore les styles en parvenant à y déterrer une identité propre, bien prête à montrer ce dont elle a dans le ventre et surtout dans la tête.
Avant de le retrouver en première partie d’Oxmo Puccino au Toboggan à Lyon le 13 mars prochain (rien que ça oui !), c’est donc avec plaisir que nous lui avons proposé de répondre à quelques-unes de nos questions concernant l’impressionnante maitrise de cette arrivée dans le game, bien qu’il s’en dise plus ou moins éloigné avec humour. Pendant 45 minutes, dans un cadre silencieux et autour de quelques bolées de cidres, Nedelko nous a parlé de son album, de ses goûts et de son avenir… Voici la synthèse de ses paroles :
Je pose toujours quelques questions assez générales pour commencer, afin d’en savoir un peu plus sur toi et ne pas rentrer directement dans le vif du sujet. Je voulais ainsi savoir ce que tu faisais de tes journées ? Est-ce que tu dédies tout ton temps à la musique ou tu fais autre chose à côté ?
Je travaille à côté, dans un bar. Sinon, soit je suis à Lyon pour faire de la musique soit je bosse sur des clips, pas forcément de moi. Je fais beaucoup de montages aussi. Je cherche des contacts, je travaille sur les lives…
Tu as d’autres passions que la musique ?
Beaucoup le cinéma, la littérature aussi. Je m’intéresse pas mal au foot.
Sinon, qu’est-ce que tu écoutes en ce moment ?
Virtue de The Voidz, l’album de fin de la musique selon moi. En terme de mélange et de cette capacité qu’ils ont à surprendre et à prendre des contrepieds, même au milieu des morceaux, je trouve ça complètement magique.
J’écoute beaucoup l’album de Pomme, Les Failles. C’est un vrai chouette album.
J’aime beaucoup Clairo, Billie Eilish.
Je vais peut-être dire du rap français aussi (rires). L’album d’ISHA, rappeur belge très fort. Sinon, tous les gens de l’Animalerie en général. Eddy Woogy qui va pas tarder à sortir son album par exemple.
Et au-delà de l’actualité, quels seraient tes 3 albums préférés de tous les temps ?
Virtue de The Voidz comme je le disais. Wish You Were Here de Pink Floyd, qui se bat en duel avec Atom Heart Mother. Et après, je mettrais surement Bossanova des Pixies. Ou peut-être OVNI d’Odezenne. Le dernier pour la valeur sentimentale surtout, il m’a ouvert quelque chose. C’était ce que je cherchais dans le rap au moment de sa sortie. C’était mystique, un peu étrange. Très rap, et en même temps tu sentais qu’ils allaient s’ouvrir sur autre chose. J’aimais bien cette période. Et j’aime beaucoup tout ce qui a suivi du coup.
« C’était complètement dingue d’intégrer ce collectif que j’admirais. C’était de l’ordre du conte de fée. Un peu crade comme conte de fée mais un conte de fée quand même »
Et ton projet, c’est celui de vivre de ta musique ?
Oui, j’espère ! C’est le but, d’en vivre décemment. Artiste intermédiaire, voir où cela peut mener, et pouvoir en vivre en faisant que ça.
Depuis quand tu fais du rap ?
Vers la fin du lycée. En terminale, j’ai commencé à écrire des choses, un peu des conneries. Pendant un ou deux ans, j’ai continué à écrire des choses sans prétentions, non pas qu’il y ait eu de la prétention après, mais j’ai ensuite commencé à écrire plus sérieusement. C’était pas très chouette au départ mais j’ai persisté, il me manquait quelques codes à assimiler. J’ai commencé à faire de bons morceaux, je pense, il y a deux ou trois ans.
Tu as appris seul au autodidacte ? Ou tu avais des personnes pour t’entourer ?
Je connaissais personne dans le milieu de la musique. Je m’enregistrais dans ma chambre ou dans l’appart d’un pote à l’époque. En rentrant de Nouvelle Zélande en 2017, j’ai fait une école de son pendant 1 an pour essayer de me professionnaliser un peu plus en terme de mix, de mastering… A la fin de cette année, j’ai contacté Yann (Oster Lapwass) par mail. J’avais envie de travailler avec lui. Il m’a demandé d’envoyer des trucs et ça a marché, il a bien kiffé.
Et comment tu connaissais Oster Lapwass à cette époque ? Je parle de son travail, sa musique, ses prods…
Je suis un très grand fan de l’Animalerie à la base. Avec Odezenne, c’est ce que je préfère en rap français. J’aime pratiquement tout ce qu’ils font. Lucio Bukowski, Eddy Woody, Anton Serra… C’était complètement dingue d’intégrer ce collectif que j’admirais. C’était de l’ordre du conte de fée. Un peu crade comme conte de fée mais un conte de fée quand même.

Comment s’est passé la rencontre avec Oster Lapwass ? Tu peux nous en dire un peu plus ?
J’ai d’abord envoyé un mail sans morceaux ni rien. J’aime pas forcer la main. J’ai attendu qu’il me le demande. J’ai envoyé des maquettes un peu propres de morceaux quasi terminés. Il m’a dit vers mai 2018 qu’il fallait qu’on bosse ensemble. Après, je suis parti en vacances deux mois et en septembre, je suis allé à Lyon pour qu’on commence à bosser ensemble sur mon premier album.
Est-ce que sur cet album, Rhéologie, on retrouve des morceaux qui datent d’avant ta rencontre avec Oster Lapwass ?
Non, non. J’en ai sorti un sur youtube, qui s’appelle « Pantagruel ». Sinon le reste, je n’aime pas. C’était plus assez actuel pour moi dans la façon dont je pouvais écrire et faire ressortir les choses. C’était trop brouillon. Je crache pas dessus, il y a certaines choses que j’ai plaisir à réécouter, mais il fallait vraiment que Rhéologie soit entièrement neuf.
J’ai l’impression que le fait de travailler avec Oster Lapwass t’a beaucoup apporté. Comme s’il avait su révéler quelque chose de toi et te proposer un univers musical parfaitement adapté à tes capacités et à qui tu es.
C’est une des grosses qualités de Yann. Peu importe avec qui il travaille – ses collaborations sont d’ailleurs très variées – il a toujours les idées qui collent aux personnalités avec qui il bosse. Ça fonctionne par binôme, c’est de l’inspiration mutuelle.
Son album d’il y a deux ans, Pense-Bête, le montre bien d’ailleurs. Dessus, il collabore avec pleins de rappeurs différents et parvient toujours à créer quelque chose d’unique en fonction des personnes. C’est assez fascinant. Avec des prods qui s’éloignent parfois du rap.
C’est pas tant que ça s’éloigne du rap mais plutôt que ça se mélange. Il a une maitrise des codes et de la transgression de ces codes-là qui est impressionnante. C’est également ma conception de la musique. Je déteste les artistes qui s’enferment dans des cases et qui ne jurent que par une seule et même chose. Dans tous les styles musicaux j’entends bien. Les mecs qui vont faire du métal pour faire du métal ou du reggae pour faire du reggae, je vais trouver ça super chiant. Ma sensibilité est dans le mélange.
De quelle manière vous avez conçu l’album avec Oster Lapwass ? Lui s’est occupé des prods et toi des textes ?
Moi, j’ai des textes que je fais sur des prods d’abord. Souvent il y a une boucle ou un début de prod à partir de laquelle je commence à écrire. De cette maquette, il retravaille la prod, il l’épaissit, il lui donne plus de cohérence avec mon propos. Parfois, j’arrive avec une face B, juste une piste sur laquelle j’ai un support, de la même manière que tu écrirais sur 3 accords de guitares et après t’en fais un morceau. Lui derrière il change complètement, il repart de zéro.
« Les tchèques utilisent Nedelko pour dire « Petit dimanche », ce qui désigne ces dimanches de flemme, d’après cuite. Le dimanche de gueule de bois quoi. »
Combien de temps ça vous a pris de concevoir l’album ?
Un an environ. Mais il y avait d’autres projets en même temps. Il y a tous les gens de l’Animalerie à côté. On aurait pu le faire plus vite mais Yann était pas mal occupé. Ça m’a permis d’épurer, j’ai enlevé certains morceaux dont je me suis rendu compte qu’ils collaient pas forcément avec ce que je voulais. J’en ai fait d’autres à la place. Par exemple, « Dolomiti » est arrivé vers la fin. On s’est dit qu’on ferait quelque chose avec Lucio (Bukowski). Un jour, j’ai écrit ce truc-là chez moi, je l’ai posé en laissant un espace, sans vraiment savoir que c’est Lucio qui le remplirait. Donc « Dolomiti » est vraiment né pendant la création. « La Baie des Chiens » également. C’est le premier morceau que j’ai balancé avec Oster. On devait sortir un truc pour me présenter. Il y avait cette compo de déjà faite. Je suis rentré chez moi et j’ai écrit un texte que j’ai posé le lendemain matin.

Ce nom, Nedelko, ça vient d’où ?
Avant tout, je m’appelle Roméo. Sauf que je pouvais pas utiliser mon prénom parce qu’il y a déjà un mec qui s’appelle comme ça sur la scène rap francophone (rires). Sinon, j’aurais utilisé Roméo, je suis pas un grand fan des pseudos. Nedelko, il y a des racines étymologiques en commun avec mon prénom, c’est un nom de l’Europe de l’Est, Macédoine, Bulgarie… Les tchèques utilisent Nedelko pour dire « Petit dimanche », ce qui désigne ces dimanches de flemme, d’après cuite. Le dimanche de gueule de bois quoi.
« Je voulais qu’ « Erosion » soit le morceau central. Il y a donc cinq morceaux avant et cinq morceaux après lui. C’est voulu et étudié. C’est le seul morceau qui n’a pas de refrain, ni de gimmick ou quoi. C’est une longue marche qui évolue »
Tu es passé direct par la case LP, sans sortir d’EP ni rien, ce qui est plutôt rare. C’était volontaire ?
Quand j’écoute quelque chose, j’avoue bien aimer quand le projet est un peu long, qu’il a une histoire. C’est difficile avec un EP, qui a souvent moins de sept titres. J’aime bien quand il y a une cohérence, une intro, un morceau qui sonne la fin, un morceau au milieu comme plaque tournante. J’avais envie de pouvoir développer cela à fond. Même les maths, dans l’album, c’est important pour moi. J’ai voulu le faire ressentir dans la manière dont je l’ai construit. D’habitude j’ai tendance à prendre un nombre pair, même si sur ce projet il est impair (11 titres). Je voulais qu’ « Erosion » soit le morceau central. Il y a donc cinq morceaux avant et cinq morceaux après lui. C’est voulu et étudié. C’est le seul morceau qui n’a pas de refrain, ni de gimmick ou quoi. C’est une longue marche qui évolue, en même temps que la prod qui est de Baptiste Chambrion. C’est le morceau le plus chargé émotionnellement, celui qui me parle le plus. C’est d’ailleurs mon préféré de l’album. Dans le morceau d’avant (« Rhéologie ») et celui d’après (« La Baie des Chiens »), on reste dans ce noyau en fait. Ils constituent le nœud du problème. Après ça se délite entre guillemets.
Et j’imagine donc que ce n’est pas un hasard que tu commences par « Phalènes » et que tu finisses par « Ombrelune » ?
« Phalènes », c’est une super intro. Je ne la voyais pas ailleurs. C’est une chouette entrée en matière, j’en suis très content.
Dans laquelle tu dis cette phrase : « on dirait la fin mais c’est peut-être l’intro ». Tu aurais pu placer le morceau en clôture ?
Oui, et je dis aussi « on dirait l’intro mais c’est peut-être la fin ». Dans l’album d’avant, qui ne sortira jamais du coup, dont cinq morceaux sont sortis avant le premier album sous le nom « prélude à Rhéologie », je parlais beaucoup de l’idée de cycle, sur laquelle j’aime bien disserter. Même si c’est pas toujours profond, c’est quelque chose qui me parle. Dès que c’est abordé de manière artistique, dans le cinéma par exemple, ça trouve écho en moi. C’est pour ça, l’intro, la fin, la fin, l’intro… J’aime bien l’idée que l’on puisse commencer par la fin. Cela rejoint cette idée de cycle.
« Phalènes » d’ailleurs prend le contrepied de ce que l’on attend. Elle commence entre guillemets sous tension, avec cette rythmique répétitive de tambours presque guerriers, puis intègre finalement un piano qui vient alléger le tout et qui fonctionne terriblement bien, alors que justement on s’attendait à ce que ça éclate à un moment. C’est très bien trouvé.
Pour le coup, c’est Yann qui a eu cette idée. On est parti sur cette rythmique, j’ai tout posé là-dessus, et il a fait évoluer le morceau de la manière dont tu peux l’entendre aujourd’hui. C’est un morceau que j’adore. Et l’intro du prochain album sera totalement différente de cela. Ce sera une intro à part entière également.
Donc tu es particulièrement attaché au fait de faire des intros ?
Oui, j’aime bien le concept d’album. Les albums que j’aime bien ont souvent un morceau qui te font rentrer dedans.
Oui, en réalité, tu fais des intros qui sont des morceaux à part entière. Ce ne sont pas moins des morceaux que les autres. Car certains albums débutent sur quelque chose qui sonne vraiment à part, allant généralement de pair avec le titre qui suit. Le début d’OVNI d’Odezenne par exemple.
Oui je vois et non ce n’est pas mon cas. Je fais un morceau à part entière mais qui va sonner particulièrement bien comme premier morceau. Un morceau introductif on va dire.
Je voulais te parler des featurings sur ton album. Tu en as fait plusieurs, dont un avec Edggar sur « Gonorrhée ». Comment s’est passé cette collab’ ?
Edggar est le dernier arrivé dans l’Animalerie juste avant moi. On traîne pas mal ensemble, on a fait des concerts, c’était assez logique. On a fait un morceau assez spécial, à part dans l’album. C’est pas vraiment ce que lui fait, ni ce que moi je fais, mais j’aime bien ce genre de prod. On l’a fait entièrement en studio en deux heures.
Et avec Olympe sur « Ombrelune » ?
Je lui ai envoyé un mail. J’ai écrit un autre EP avec des chansons pas rappées. J’avais besoin de quelqu’un avec une voix cool, une personnalité. Elle me faisait marrer avec ses covers, tu sentais qu’il y avait un peu de second degré là-dedans. Donc je lui ai proposé en même temps d’intégrer Rhéologie dans la chanson qui clôture l’album. La collab’ s’est super bien passée.
« Je pense que je ne mettrais jamais ma tête en cover. J’ai l’impression que tu perds le propos quand tu fais ça. »
Tu as pour projet de t’éloigner du rap ?
Pas vraiment, ce sera toujours hybride. Beaucoup de refrains dans l’album sont chantés. Je cherche toujours des mélodies, des notes. Il y a des morceaux où on est vraiment sur du chanter, mais toujours avec cette écriture rap dans le sens rimique du terme, dans le quadrillage et la symétrie.
Tu le dis dans « Phalènes » d’ailleurs avec « je fais plus que du rap et j’emmerde le jeu ».
Oui oui, après c’est plus de la provoc’. Je cherche pas tellement à rester dans une case comme je te disais tout à l’heure. J’adore les codes, j’adore les connaître et les maitriser, être très bon, mais j’adore aussi les mélanger. C’est nécessaire. Mais avant tout, il faut être fort techniquement.
« La transformation sous la contrainte, c’est ce dont je parle dans l’album »

Pour ce qui est de la cover de l’album, extrêmement belle, d’où vient-elle ?
C’est un ami à moi, Matthieu Cattoni, qui a fait le clip de « Dolomiti ». Il a pris cette photo un soir sur la plage avec des amis à lui. Elle me parlait vachement par rapport aux thématiques de l’album. Ça faisait sens. J’aime bien les deux figures floues dessus. Une cover, c’est très important, c’est la porte d’entrée au projet. Par exemple, je pense que je ne mettrais jamais ma tête en cover. J’ai l’impression que tu perds le propos quand tu fais ça.
Et le titre de l’album « Rhéologie », dont tu dis dans le morceau titre que c’est « l’étude des matériaux et de leur transformation », comment tu l’as trouvé ?
L’étude de la transformation des matériaux sous la contrainte. Appliqué à l’homme, je trouve que c’est génial. La transformation sous la contrainte, c’est ce dont je parle dans l’album. Ça synthétise beaucoup de choses que j’ai vécu ces cinq dernières années, de 19 à 24 ans. C’est une période où tu changes énormément. C’est un âge où tu es parfois obligé de changer. Les gens pensent que c’est un titre compliqué alors que je le trouve assez simple et abordable, à condition de se renseigner et de connaître la signification de ce mot particulier et peu courant, mais que j’explique finalement dans la chanson. Pour la petite histoire, j’étais parti deux mois en vacances avant d’arriver à Lyon. J’ai passé un peu de temps aux Etats-Unis avec un ami biologiste. On était dans le Grand Canyon et il m’expliquait plein de choses très intéressantes dont la rhéologie. J’ai adoré le mot et ce qu’il signifiait. Alors mon ami m’a dit d’appeler mon album comme ça. Du coup, il n’y a pas eu à réfléchir au nom, il s’est imposé de manière évidente.
Et donc tu as dû faire un morceau sur ce thème-là, qui est le morceau titre ?
Je l’ai écrit un peu plus tard dans le voyage. Je l’ai écrit dans les bois à 6h du mat’ (rires). Ça fait un peu mystique comme ça et d’ailleurs ça l’était un peu. Il faisait trop froid, je pouvais pas dormir donc je me suis levé, j’ai enfilé deux pantalons, plusieurs paires de chaussettes et je suis allé écrire dans un parc naturel là-bas. C’était pas super intelligent parce qu’il y a des ours là-bas. Je suis tombé nez à nez avec un cerf. C’était un moment incroyable en dehors de tout.
Ce morceau en fait, il parle de l’étude du matériau humain ?
Exact, la façon dont on change en fonction de qui, de quoi et de quand…
J’ai l’impression que tu as du mal à t’attacher aux autres. C’est ce que me font penser certains de tes textes : « peut-être que j’aime que le début des gens » « ça ne m’empêchera pas de me lasser du goût des autres »…
C’est plus une peur qu’une réalité. C’était justement après une histoire avec une personne à laquelle j’étais très attaché. Après ça, tu as plus de mal à te greffer à quelqu’un d’autre, même à supporter les gens. Tout à coup, tu t’en lasses vite. Ça devient rapidement une crainte, de te dire que tu es à ce point superficiel. Mais en fait, ce sont des passages. Tout est passage finalement
Et faire cet album, ça a changé quelque chose de toi tu penses ?
A partir du moment où c’est réfléchi, tu te transformes. C’est difficile de rien vivre et c’est que lorsque tu ne vis rien que tu ne te transformes pas. Depuis l’album, j’ai vécu tellement de choses que oui forcément j’ai changé. Perpétuellement en fait. Mais ces derniers temps, il y a moins l’idée de contrainte tu vois. Elle y est parfois, mais beaucoup moins.
« Je cherche pas à mettre des mots compliqués ou quoi et je considère pas forcément mon écriture comme ultra littéraire. Après, je ne prends jamais les gens pour des cons, alors que certains ont trop l’habitude de le faire. J’estime que tout le monde est capable de s’y retrouver. »
Sur l’album, tu dévoiles plusieurs facettes de toi, comme sur le morceau « Gaspard Delevingne », où tu sembles te positionner à la fois du côté de Cara Delevingne et à la fois du côté de Gaspard Noé. Tu dis être en même temps gentil, pur mais aussi violent et lugubre. C’était ça l’idée dans ce morceau ? De dévoiler un double visage ?
Il y a carrément de cela mais en fait il y a trois points à retenir dans ce morceau. C’est un peu un mélange de tout donc il est souvent pas bien compris. Il faut avoir les clés de lecture et je les donne pas forcément parce que j’aime bien que l’on me dise sa vision personnelle. Les gens ont parfois des interprétations géniales donc c’est cool de laisser ouvert. C’est facile d’attribuer à mes morceaux un biais personnel pour les comprendre à sa manière. C’est ce que j’aime.
Pour « Gaspard Develingne » donc, c’est l’idée de mettre l’inatteignable, le trop parfait dans le réel cru et pur. Je trouve que Gaspard Noé a un cinéma ultra réel, dans le sens où il romantise jamais les choses. Parfois, on lui reproche justement, mais il a cette force de montrer les choses telles qu’elles sont. Comme cette scène insoutenable dans Irréversible où c’est la première fois que l’on ne romantise pas le viol au cinéma, ce que l’on a tendance à beaucoup faire je trouve. Et Cara Delevingne, c’est l’exact inverse. Je l’ai choisi elle mais j’aurais pu parler de n’importe quelle autre star qui est sans cesse magnifié, idolâtré. Comme quelque chose d’intouchable que l’on nous vend. Et je trouve ça ultra pervers car je suis certain que Cara Delevingne a pleins de soucis et n’est pas la déesse que l’on essaye de nous vendre. L’idée, c’était donc de mettre du beau dans le sale et du sale dans le beau. La beauté dans le réel et du réel dans la beauté. Pour résumer. C’est un morceau très métaphorique.
Le morceau parle aussi de sexualité. A quel moment tu es influencé ou non par ton vécu sexuel ? A quel moment ce que tu fais tu as envie de le faire ou alors tu l’as intériorisé par des traumatismes ? « Gaspard Delevingne » parle aussi de ça. Je me réfère à une relation que j’ai vécue moi-même. C’est un sujet qui me travaille même si j’essaye souvent de rester pudique. Il faut faire très attention à comment tu interagis avec les personnes, selon leur vécu, selon leurs traumatismes…
Tu as une façon d’écrire assez littéraire, qui peut déplaire à certains lui reprochant d’être trop sophistiquée, ou d’être trop éloignée de ta manière de parler de tous les jours par exemple. J’ai vu un seul commentaire sur ce point mais j’ai trouvé ces reproches assez absurdes, dans le sens où le but n’est pas de rapper comme tu parles. Je voulais tout de même avoir ton avis sur ta façon d’écrire, comment ça vient, si tu y réfléchis longtemps ?
Personne ne parle comme il chante ou comme il écrit. Je ne cherche pas quand j’écris. J’ai du vocabulaire, enfin j’imagine, et les mots me viennent par rapport au rythme en fait. C’est très géométrique en fait. C’est de la technique. Je cherche pas à mettre des mots compliqués ou quoi et je considère pas forcément mon écriture comme ultra littéraire. Après, je ne prends jamais les gens pour des cons, alors que certains ont trop l’habitude de le faire. J’estime que tout le monde est capable de s’y retrouver.
Qu’est-ce que tu prévois pour le futur ? Des projets en prévision ?
On est sur le deuxième album avec Yann (Oster Lapwass) et plusieurs autres producteurs. Je travaille sur les noms qu’il y aura, j’ai envie que ce soit différent. Et puis quelques concerts, dont la première partie avec Oxmo le 13 mars.
Super, je crois que l’on peut s’arrêter ici. Merci beaucoup pour cet entretien !
Merci à toi !