A chaque Rock en Seine, annonce flamboyante de la rentrée, sa spécificité. Il a été des Rock en Seine thématiques, des très (trop) chaud, d’autre sous la pluie, des très rock, des orientés découvertes. Chaque année le domaine de Saint-Cloud s’habille aux couleurs du célèbre festival. En ce deuxième jour, soit le samedi 25 août, la pluie a laissé place au beau temps et donc à un arc-en-ciel de tonalités musicales ( ce jeu de mot a été réalisé sobre, moi-même je ne comprends pas).
Cette journée de Rock en Seine qui fête en 2017 ses 15 ans promet de chiller.

Sur la Grande Scène, Band of Horses se présente en plein soleil. Début de journée festivalière ou pas, le public est présent. C’est amusant de découvrir dans le cadre particulier d’un festival, un artiste qu’on a connu ailleurs. Ainsi, le groupe habitué en France à de plus petites scènes ( la Flèche d’Or entre autre, la fois où celle qui écrit ses lignes les avait vus) se retrouve ici propulsé sur la plus grande scène de l’immense festival. Les titres à la cool s’enchaînent. La voix rauque du meneur de la formation rappelle celle de Bush. Les interactions sont classiques. Globalement le combo est heureux d’être là. Le moment clés se situe sur « The Funeral », titre phare du groupe, single excellent, que certains ont pu entendre dans des séries US ( coucou « Les frères Scott » des débuts). Si la formation a plus à offrir dans un espace plus restreint, ne s’en défend pas moins.
Comme toujours en festival il ne faut pas chômer, il est donc l’heure de courir vers la scène de la Cascade pour voir Girls in Hawaii.
Un moment très doux côté scène qui côté public l’est tout autant. Le devant de scène est rempli, nombreux sont ceux qui souhaitaient découvrir le combo en live. La pop hypnotisante de la formation est belle, envoûtante. On se prend à regretter qu’il ne fasse pas nuit pour l’écouter et qu’on ne soit pas su r une scène plus intime pour communier pleinement avec les autres festivaliers.
r une scène plus intime pour communier pleinement avec les autres festivaliers.
Mais Rock en Seine se sont également de nombreuses activités proposées par le festival comme par ses partenaires. Ce jour là, la plus impressionnante est bien celle offerte par Wiko.
Un grue qui tracte dans les airs un bar géant offrant une voix magnifique sur Saint-Cloud et Paris le tout en prenant des selfies avec le nouvel appareil de la marque. Dans les airs, Jain débute son set.

D’en haut la foule y est dense, compacte, dansante, déchaînée. Le morceaux volent dans les airs, caressent ceux qui sont à 50 mètres du sol et qui admirent au passage, la Tour Eiffel, la Seine, les scènes… on s’envoie en l’air avec la chanteuse qui elle fait aussi voler la foule de la Grande Scène.
Une fois redescendus sur la terre ferme, il faut traverser une partie du festival, son parc et les nombreuses feuilles mortes abandonnées par ses arbres en périphérie du camping. Malgré la très lourde chaleur, cet habillage marron rappelle la rentrée et l’automne qui approchent à grands pas.
Jain elle, n’oublie pas l’actualité et demande à l’assistance de lever les doigts au ciel en symbole de la paix pour chanter son titre hommage aux attentats de Paris.

« Ce n’est pas facile de se réunir de nos jours alors merci à tous d’être là. » Cette femme orchestre s’amuse avec sa pédale de loop, enregistre les chants d’un des membres de son public sur « Come » pour le répéter alors qu’elle interprète en live son morceau. Toujours plus forte, elle se jette dans la foule dans une boule transparente et donne un nouveau souffle au générique de « L’inspecteur Gadget ».
Devant Her en revanche sur la scène du Bosquet, c’est le souffle court que le public accueille le groupe. Victor Soffle très ému y livre une performance sans faille.  Il promettait sur les réseaux sociaux de « continuer coûte que coûte cette magnifique aventure. C’est aujourd’hui son héritage que je porte en moi et c’est ma volonté ainsi que celle de toute l’équipe de Her de continuer à emmener notre musique le plus loin possible. » et ce, malgré la tragique disparition cet été de la moitié et co-fondateur de Her, Simon Carpentier des suites d’un cancer.
Il promettait sur les réseaux sociaux de « continuer coûte que coûte cette magnifique aventure. C’est aujourd’hui son héritage que je porte en moi et c’est ma volonté ainsi que celle de toute l’équipe de Her de continuer à emmener notre musique le plus loin possible. » et ce, malgré la tragique disparition cet été de la moitié et co-fondateur de Her, Simon Carpentier des suites d’un cancer.
Le meneur choisi de chanter, de se donner au maximum, note après note, rendant sa soul encore plus sublime. Lorsqu’il prend le micro et évoque « ce dernier titre qu’on a écrit avec Simon. », mais surtout « cette aventure tellement énorme qu’on a vécu avec Simon alors qu’on a débuté sur Soundcloud et aujourd’hui on est là à Rock en Seine. » les larmes dans sa gorge nouée se font presque entendre. Les musiciens du groupe de noir vêtus portent le deuil, le leader, lui reste en noir et blanc, les couleurs du groupe. En suit un moment de communion rare, devant un parterre comble. Les promesses faites à Simon sont tenues. Le travail du groupe laissera c’est certain une empreinte éternelle sur ceux qui l’écouteront.
La nuit tombe et les lives se succèdent, The Kills déchaîne les foules sur la Grande Scène alors que Lee Fields & The Expressions convainc tous ceux qui les découvrent.
22 heures sonnent et la prêtresse de la soirée, madame PJ Harvey s’avance sur scène. De noir vêtue, la légende met Rock en Seine en apesanteur. Une brise s’éveille et elle colle parfaitement avec la voix cristalline et envoûtante de la star. Côté foule, on reste calme, pris dans le tourbillon de la chanteuse. Quelques chuchotements s’élèvent « Elle est grandiose » osent murmurer certains.  Seul un groupe passant d’une scène à l’autre et chantant en boucle « Mélanchon, Mélanchon, Mélanchon » osent troubler la quiétude du moment. Entre son saxophone et ses musiciens de génies, PJ Harvey crée une atmosphère apaisante. Le talent est là, brut, indéniable. Des enfants grimpent sur les épaules de leurs parents, on ose détourner les yeux de la scène avares d’en vivre un maximum. Le rappel sera pour elle l’occasion de chanter un petit peu de Bob Dylan. Un moment de magie brut.
Seul un groupe passant d’une scène à l’autre et chantant en boucle « Mélanchon, Mélanchon, Mélanchon » osent troubler la quiétude du moment. Entre son saxophone et ses musiciens de génies, PJ Harvey crée une atmosphère apaisante. Le talent est là, brut, indéniable. Des enfants grimpent sur les épaules de leurs parents, on ose détourner les yeux de la scène avares d’en vivre un maximum. Le rappel sera pour elle l’occasion de chanter un petit peu de Bob Dylan. Un moment de magie brut.
Fakear propose une fête géante pour conclure l’une des dernières soirées que l’été a choisi de nous offrir. Pas de nostalgie à avoir, Rock en Seine continue demain.
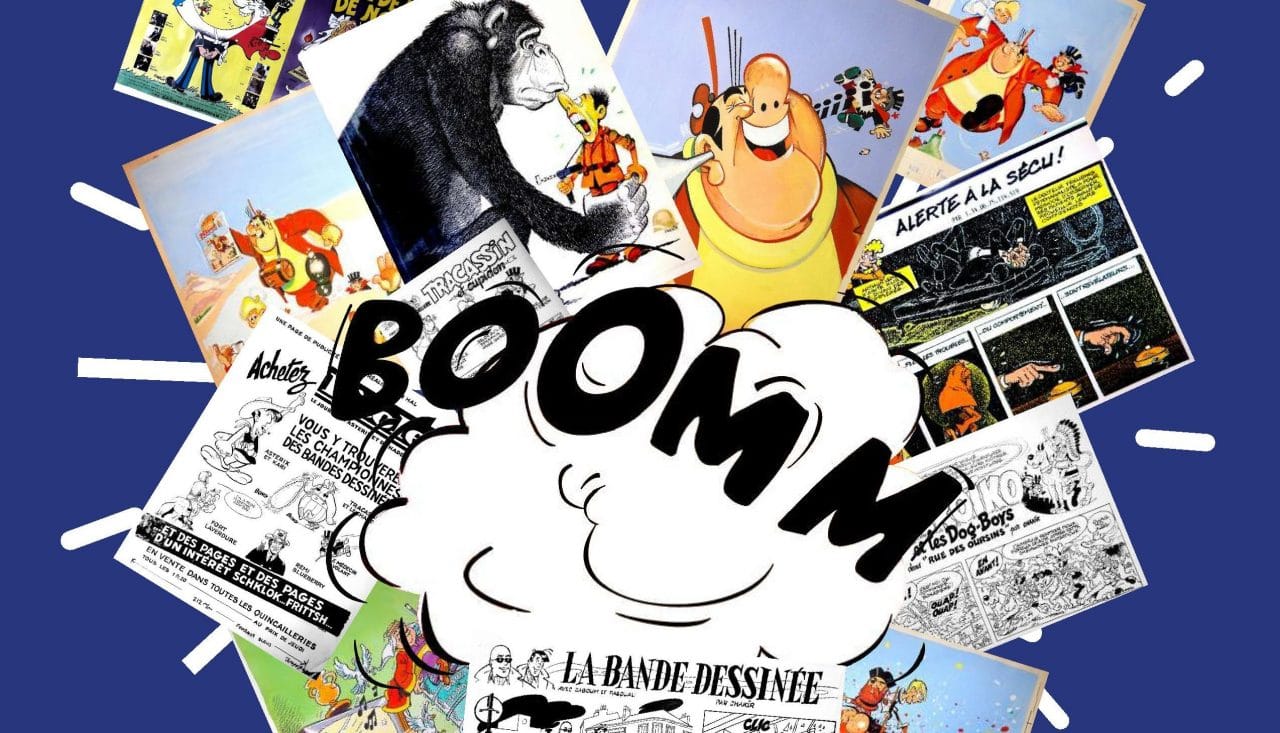








 r une scène plus intime pour communier pleinement avec les autres festivaliers.
r une scène plus intime pour communier pleinement avec les autres festivaliers.

 Il promettait sur les réseaux sociaux de « continuer coûte que coûte cette magnifique aventure. C’est aujourd’hui son héritage que je porte en moi et c’est ma volonté ainsi que celle de toute l’équipe de Her de continuer à emmener notre musique le plus loin possible. » et ce, malgré la tragique disparition cet été de la moitié et co-fondateur de Her,
Il promettait sur les réseaux sociaux de « continuer coûte que coûte cette magnifique aventure. C’est aujourd’hui son héritage que je porte en moi et c’est ma volonté ainsi que celle de toute l’équipe de Her de continuer à emmener notre musique le plus loin possible. » et ce, malgré la tragique disparition cet été de la moitié et co-fondateur de Her,  Seul un groupe passant d’une scène à l’autre et chantant en boucle « Mélanchon, Mélanchon, Mélanchon » osent troubler la quiétude du moment. Entre son saxophone et ses musiciens de génies, PJ Harvey crée une atmosphère apaisante. Le talent est là, brut, indéniable. Des enfants grimpent sur les épaules de leurs parents, on ose détourner les yeux de la scène avares d’en vivre un maximum. Le rappel sera pour elle l’occasion de chanter un petit peu de
Seul un groupe passant d’une scène à l’autre et chantant en boucle « Mélanchon, Mélanchon, Mélanchon » osent troubler la quiétude du moment. Entre son saxophone et ses musiciens de génies, PJ Harvey crée une atmosphère apaisante. Le talent est là, brut, indéniable. Des enfants grimpent sur les épaules de leurs parents, on ose détourner les yeux de la scène avares d’en vivre un maximum. Le rappel sera pour elle l’occasion de chanter un petit peu de 
