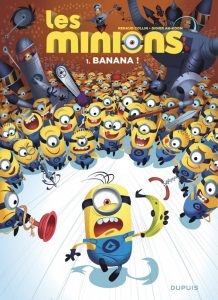Dans moins d’un mois ce sera Noël. Cotillons, dinde aux marrons, mauvais mousseux, cadeaux revendus le lendemain même sur Internet…Bref la tradition ! Mais surtout l’occasion unique de se retrouver en famille… A Pop&Shot, on aime bien le cinéma de genre. Du coup, on a décidé d’inaugurer une nouvelle rubrique en vous présentant les pires membres de la famille du cinéma de genre dont on a pu se souvenir…
La famille est un concept plus que primordial dans la fiction américaine. Et plus encore au cinéma. Poussant parfois la logique jusqu’à l’absurde, comme avec le personnage de Vin Diesel, qui n’a pas une ligne de dialogue sans le mot « famille » dans les derniers Fast and Furious pour justifier le lien entre les membres de son groupe, la notion peut sembler oxydée pour nous autres français, qui sommes bien plus cyniques, c’est bien connu. Quoi de plus effrayant alors que de voir ce cocon censément rassurant, se voir attaquer par une menace extérieure ? Le cinéma de genre, terme vague et indéterminé on est d’accord, a bien sur eu l’occasion de montrer des familles soumises à diverses menaces, humaines ou surnaturelles. Comme pour tout, il y a des réussites et des ratés. Sans être un chef d’œuvre, loin de là, dernièrement, The Darkness réussissait à montrer une famille crédible évoluée sous nos yeux. A contrario, le remake de Poltergeist…. Bon, ne tirons pas sur une ambulance en feu, d’accord…. Même si… Oui, bon d’accord, enchaînons. Des personnages ratés ou horripilants, au fil des années, il y en aura eu un paquet qui auront défilés sur les écrans. En prenant le format d’une famille caricaturale, voici donc ma sélection des pires membres de la famille du cinéma de genre. En toute subjectivité. Et en toute mauvaise foi. N’hésitez pas à donner vos propres avis dans les commentaires !
Le père de famille
Eric Bowen ( Sam Rockwell) dans Poltergeist ( 2015)

Papa est chômeur et père de famille nombreuse. Il a le trauma bien connu du footballeurquis’estblesséalorsqu’ilauraitpufaireunegrandecarrière, trouble qui touche environ un personnage dans une fiction sur deux aux États Unis. Endetté, il a fait s’installer sa famille pile au dessus d’un ancien cimetière. Alors que le climax ultime du film dans lequel il évolue semble être cette scène déchirante ou le bon père de famille se demande si sa carte de crédit va passer à la caisse du supermarché, on le voit la scène suivante débouler avec une demi-douzaine de pizzas alors que toute la famille a déjà mangé ou n’a plus faim et ayant claqué pour faire des cadeaux à ses enfants. Responsable, le père de famille. Il négocie ardemment le droit de pouvoir sauter exercer le devoir conjugal, une tasse à café remplie de whisky à la main, avec le mythique combo caleçon-chaussettes. Et quand, son fils préado agressé par des esprits, a le malheur d’appeler à l’aide, il se fout amplement de sa tronche devant toute la famille. Passablement perturbé par la disparition de sa fille dans le téléviseur (non en fait c’est pour être poli, il semble s’en cogner éperdument), mettant autant d’intensité dans la résolution de cette énigme que dans la recherche de la deuxième chaussette qui manque après avoir fait une machine, il mettra une bonne dizaine de scènes avant de se résoudre à tourner au sky dès le réveil… Un père modèle comme on les aime : continue comme ça Eric t’es un champion !
Son atout en cas de menace : il restera imperturbable en toutes circonstances… Ouais, il s’en cognera éperdument quoi. Tant que bobonne accepte de…
La mère de famille
Tracy Weaver (Samantha Ferris) dans The Secret (2012)

Avec une trogne à ne pas boire que de l’eau, maman a un job au rabais ou est au chômage longue durée, on ne sait pas trop. Elle pense qu’à elle mais elle tente de se rassurer en revenant parfois vers sa fille, adolescente qui ne dit pas un mot tellement elle s’épanouit dans le foyer, avant de retourner hilare dans les bras de celui qui fait office de beau père maltraitant. Incarnation d’une certaine vision de la mère de famille célibataire white trash de la campagne américaine, la scène ou elle cherche à s’en prendre à son compagnon maltraitant avant de finalement céder et finir dans ses bras est au final le moment le plus glaçant du film…
Son atout en cas de menace : pas de danger, elle se sera déjà tirée, hilare, avec le camionneur du bout de la rue !
La grande sœur
Rebecca (Teresa Palmer) dans Dans le noir (2016)

Rebecca s’est tirée du foyer familial très jeune et est partie dans « la grande ville ». Moyennant une grande faculté, elle n’aura pas réussi à percer dans ce qu’elle voulait. Fuyant un grand benêt intrus qui veut qu’à fourrer des chaussettes dans son tiroir, elle trouve sa rédemption dans l’appel d’une assistante sociale qui lui duit que son petit demi frère-dont elle s’est cognée jusque là- est en danger. A partir de ce moment, elle mobilisera le dit-petit ami et ira jusqu’à s’opposer à la fameuse assistante sociale (dont le rôle justement ne va pas au delà de trois scènes) pour préserver la vie de son demi frère. Ne donnant jamais sa chance à son fameux petit ami, elle ira jusqu’à risquer sa vie pour protéger la vie de la famille dont elle s’est souvenue de l’existence récemment…
Son atout en cas de menace : Mettre en avant dans la mêlée le fameux fourreur de chaussettes, le petit ami dont tout le monde se fout au point de pas avoir retenu son nom, mais qui fait un bon candidat pour le body count jusqu’au générique final. Il suffit de lui promettre un tiroir à chaussettes, même s’il a peu de chances de s’en tirer…
La petite sœur
Lilly (Isabelle Neulisse) dans Mama (2013)

La petite Lilly vous mettra une ambiance de feu au réveillon ! Sapée comme une souillonne, peu alphabétisée, elle remettra en cause la méthode globale… Mettant une ambiance de dingue en buggant sur une forme au dessus de votre tête en haut du meuble tout au long de la soirée, vous regretterez de l’avoir prise avec vous… Mettant du pastel de couleur sur les murs blancs qui vous ont coûtés un bras, vous finirez par haïr la petite… Aussi quand, au moment d’un soi-disant choix décisif, elle préférera se tirer avec l’esprit d’une vague meuf vivant au fond des bois, contrairement à sa sœur plus âgée, vous serez ravis. C’est toujours ça de pris en moins en contrôle par la DDASS…
Son atout en cas de menace : Une fameuse Mama que personne de vivant n’a vu mais qui semble avoir une certaine influence auprès d’elle et qui se met souvent en haut des meubles…
Le petit frère
Samuel (Noah Wiseman) dans Mister Badabook (2014)

Gros relou habituellement occupé sur sa console, le petit Samuel vous mettra vite hors de vous : Appelant sa mère constamment, se frittant avec les autres mômes de la soirée, il vous prendra vite l’envie similaire aux personnes présents dans la même pièce à savoir étrangler le petit Samuel. Véritable publicité pour l’avortement, le petit bonhomme continuera de s’agiter en gesticulant, vous faisant regretter, vraiment, de ne pas avoir assez pris en compte les mises en garde du Ministère de la Santé sur les moyens contraceptifs….
Son atout en cas de menace : Qui que ce soit s’approchant de lui, finira par s’enfuir en courant, excédé devant l’ampleur du phénomène….
Les meilleurs amis de la famille
Ashley et Peter ( Corbin Reid et Peter Scott) dans Blair Witch (2016)

Ashley et Peter sont des gens biens. Vraiment. Il suffit qu’ils aperçoivent vaguement, de loin, un Dixie Flag pour décréter que les habitants de la résidence sont des rednecks sans foi ni confiance. Se foutant éperdument de leurs tronches, ils perdront toute sympathie, en même temps que tout les acteurs du film dont ils proviennent… La condescendance citadine qu’ils font preuve à l’égard du couple de ploucs n’aide pas non plus… Aucune empathie ne finira par être développée par la mise en scène, et du coup quand leur disparition de la pellicule interviendra, on sera à deux doigts de pousser un ouf de soulagement tellement ce couple aura été là pour faire passer le temps et préserver les personnages principaux…
Leurs atouts en cas de menace : Avec le statut quasiment gravé sur le front de première victime, ils prendront tout sur eux en premier en cas d’attaque, ce qui permettra de tenir en attendant que le petit matin se lève…
La voisine esseulée
Evelyn ( Alfre Woodward) dans Annabelle (2015)

On aurait pu choisir M. Preskovitch du Père Noël est une ordure, mais ça aurait été hors sujet… Evelyn est une voisine charmante bien qu’esseulée. Elle porte le deuil de sa fille, s’intéresse à l’ésotérisme et ne sort de son appartement que pour accoster les gens qu’elle juge en péril dans les vieilles librairies… Inutile de dire qu’on a de quoi ruminer contre la maîtresse de maison si elle vous place à coté d’elle au réveillon. Totalement dévouée et bonne poire, elle n’hésite pas à sauter par la fenêtre en cas de péril afin de préserver une famille en détresse qu’elle connaît depuis à peine trois jours.
Son atout en cas de menace : Son sens absolu du sacrifice, qui devrait permettre de gagner du temps, alors qu’elle cherchera tout les moyens possibles pour mourir en vain…
Le tonton relou
Michael Young ( Barry Watson) dans Ominous (2015)

Tonton Michael a des problèmes d’alcool. Un demi-verre de Champomy et c’est un danger au volant. A la vitesse faramineuse de 5km/h, il renverse enfants et animaux sans même s’en rendre compte. En plus de son addiction (le Champomy c’est le mal), il affiche un air constipé sérieux en toutes circonstances et ne vous décochera pas un sourire pour rien au monde.
Son atout en cas de menace : Une coupette. Une voiture. Et il renversera tout sur son passage.
Le p’tit neveu
Cody ( Jacob Tremblay) dans Before I wake ( 2016)

Cody a la poisse : orphelin, dans chaque famille ou il passe, les parents finissent décimés… La faute à des pouvoirs psychiques lui permettant de faire apparaître aussi bien ses rêves que ses cauchemars. Et pour son age, le petit Cody en a de sacrés des cauchemars. Notamment, le canquère, créature démoniaque tourmentant et dévorant régulièrement son entourage. En somme, il faut éviter de dormir dans le même endroit que lui…
Son atout en cas de menace : son manque d’alphabétisation. N’importe quel mot qu’il lira de travers fera apparaître un monstre qui absorbera tout sur son passage.