The Virgin Suicides : un air de pop mélancolique
 Sortie le 25 février 2000, la bande originale de « The Virgin Suicides » vient parfaitement accompagner l’un des films les plus marquants de la filmographie de Sophia Coppola. Fresque acide d’une adolescence féminine, la douceur vient y côtoyer l’horreur alors que la jeunesse y cristallise toutes les angoisses. Elle y devient le vivier d’une vie qui ne peut ni changer ni s’améliorer. La sororité de protagonistes s’enlise, sous nos yeux impuissants, vers le pire alors qu’un premier drame a déjà touché leur famille. Qu’est-ce qui peut être si grave à 14 ans ? Si vous posez la question, docteur, c’est que vous n’avez jamais été une adolescente de 14 ans, répondra le film. Comme pour toutes œuvre de Coppola, la douceur pastel vient se confronter à la difficulté. Il fallait souligner les sentiments qui règnent en maître sur un film à fleur de peau, et quoi de mieux que la musique pour les personnifier ? C’est Air qui se charge d’écrire la bande-son parfaite. Choix idéal s’il en est. On doit à ce monument l’immense titre « Playground love ». Probablement le plus beau morceau de la formation, son rythme entrainant, ritournelle amère et à vif, portée par les voix aériennes du duo français. Le résultat est tout simplement à couper le souffle. D’ailleurs le titre sera par la suite repris en clôture des jeux Olympiques de Paris ! Cette merveille aérienne, aussi douce que les images qu’elle porte est le premier titre d’une bande son divine qui vaudra au comparses une victoire de la musique en 2001. D’autres merveilles la peuplent de l’envoûtant « Cemetary Party » (quel talent d’écriture ont Godin et Dunckel !) ou encore l’habité « Ghost Song », morceau hanté s’il en est. Le disque 2 réunit sur cette soundtrack une jolie bande d’artistes et s’offrait une nouvelle sortie au Disquaire Day 2025. Les festivités s’y ouvrent sur Heart, voix féminine au couteau qui crie le désespoir. Mais on y trouve aussi d’inoubliables surprises : de la pépites Sloan et son « Evrything you’ve done wrong », au puissant « The Air that I breathe » de The Hollies ( quasi bowie-eque dans sa composition) sans oublier de citer Al Green. Tout y a une sensibilité parfaite. Sans doute, la plus belle des tenues à revêtir sur ses oreilles pour sentir ses 16 ans crier – à nouveau – les douleurs oubliées.
Sortie le 25 février 2000, la bande originale de « The Virgin Suicides » vient parfaitement accompagner l’un des films les plus marquants de la filmographie de Sophia Coppola. Fresque acide d’une adolescence féminine, la douceur vient y côtoyer l’horreur alors que la jeunesse y cristallise toutes les angoisses. Elle y devient le vivier d’une vie qui ne peut ni changer ni s’améliorer. La sororité de protagonistes s’enlise, sous nos yeux impuissants, vers le pire alors qu’un premier drame a déjà touché leur famille. Qu’est-ce qui peut être si grave à 14 ans ? Si vous posez la question, docteur, c’est que vous n’avez jamais été une adolescente de 14 ans, répondra le film. Comme pour toutes œuvre de Coppola, la douceur pastel vient se confronter à la difficulté. Il fallait souligner les sentiments qui règnent en maître sur un film à fleur de peau, et quoi de mieux que la musique pour les personnifier ? C’est Air qui se charge d’écrire la bande-son parfaite. Choix idéal s’il en est. On doit à ce monument l’immense titre « Playground love ». Probablement le plus beau morceau de la formation, son rythme entrainant, ritournelle amère et à vif, portée par les voix aériennes du duo français. Le résultat est tout simplement à couper le souffle. D’ailleurs le titre sera par la suite repris en clôture des jeux Olympiques de Paris ! Cette merveille aérienne, aussi douce que les images qu’elle porte est le premier titre d’une bande son divine qui vaudra au comparses une victoire de la musique en 2001. D’autres merveilles la peuplent de l’envoûtant « Cemetary Party » (quel talent d’écriture ont Godin et Dunckel !) ou encore l’habité « Ghost Song », morceau hanté s’il en est. Le disque 2 réunit sur cette soundtrack une jolie bande d’artistes et s’offrait une nouvelle sortie au Disquaire Day 2025. Les festivités s’y ouvrent sur Heart, voix féminine au couteau qui crie le désespoir. Mais on y trouve aussi d’inoubliables surprises : de la pépites Sloan et son « Evrything you’ve done wrong », au puissant « The Air that I breathe » de The Hollies ( quasi bowie-eque dans sa composition) sans oublier de citer Al Green. Tout y a une sensibilité parfaite. Sans doute, la plus belle des tenues à revêtir sur ses oreilles pour sentir ses 16 ans crier – à nouveau – les douleurs oubliées.
Juno : la bande originale de la mélodie de la fin de l’enfance
 Quelques notes d' »All I want is you » de Barry Louis Polisar résonnent à peine. Ses cordes aigües et ses envolées joyeuses sentent l’Amérique traditionnelle, et ça y est, nous voilà plongé.es dans l’univers de doux-amer de « Juno ». Elliott Page y interprète une jeune fille à l’esprit libre et qui n’a pas la langue dans sa poche. A 16 ans, elle tombe enceinte accidentellement et décide de donner son enfant à l’adoption et de lui chercher la meilleure famille possible. Elle devra à mesure que l’accouchement approche, faire preuve de la plus grande des maturité. C’est un sujet lourd qui est ici traité avec une jolie forme de légèreté et d’humour. Il fallait pour l’accompagner une bande-son propre à son époque. Et quelle réussite alors que la sélection d’artistes présent.es donne le tournis ! Impossible de ne pas parler de la présence de « Piazza, New York Catcher », chef d’œuvre de Belle and Sebastian et sa légèreté pop rock enivrante. Ce n’est qu’une pierre pourtant dans l’immensité d’une bande originale qui ne fait pas un seul faux pas. Kimya Dawson ajoute sa touche de liberté à cette compil entre ritournelle et beautés pop sortie en décembre 2007. On y sautille comme une adolescente rebelle, alors que ses paroles viennent apporter une touche de gravité à la mélodie. C’est d’ailleurs Elliott Page qui suggèrera de l’ajouter à la bande-originale tout comme le désabusé « Anyone Else but you » et sa poésie légère signé The Moldy Peaches. Les acteurs principaux, Elliott Page et Michael Cera en feront d’ailleurs une repris, présente sur la dernière piste de l’album. Cette interprétation c’est aussi celle que l’on retrouve dans l’une des scènes du film, moment de complicité entre nos deux ados perdus. Un titre d’autant plus important que c’est l’acteur principal (qui n’avait pas encore fait son coming out trans à l’époque) qui suggère au réalisateur, Jason Reitman, d’utiliser ce titre pour personnifier les goûts musicaux de Juno. Toute la bande originale choisit le clair-obscur pour se faire inoubliable. Enfantin, « Vampire » de Antsy Pants, le groupe de Kimya Dawson, reste un temps fort d’un album qui s’écoute encore et encore pour y trouver une belle dose de candeur.
Quelques notes d' »All I want is you » de Barry Louis Polisar résonnent à peine. Ses cordes aigües et ses envolées joyeuses sentent l’Amérique traditionnelle, et ça y est, nous voilà plongé.es dans l’univers de doux-amer de « Juno ». Elliott Page y interprète une jeune fille à l’esprit libre et qui n’a pas la langue dans sa poche. A 16 ans, elle tombe enceinte accidentellement et décide de donner son enfant à l’adoption et de lui chercher la meilleure famille possible. Elle devra à mesure que l’accouchement approche, faire preuve de la plus grande des maturité. C’est un sujet lourd qui est ici traité avec une jolie forme de légèreté et d’humour. Il fallait pour l’accompagner une bande-son propre à son époque. Et quelle réussite alors que la sélection d’artistes présent.es donne le tournis ! Impossible de ne pas parler de la présence de « Piazza, New York Catcher », chef d’œuvre de Belle and Sebastian et sa légèreté pop rock enivrante. Ce n’est qu’une pierre pourtant dans l’immensité d’une bande originale qui ne fait pas un seul faux pas. Kimya Dawson ajoute sa touche de liberté à cette compil entre ritournelle et beautés pop sortie en décembre 2007. On y sautille comme une adolescente rebelle, alors que ses paroles viennent apporter une touche de gravité à la mélodie. C’est d’ailleurs Elliott Page qui suggèrera de l’ajouter à la bande-originale tout comme le désabusé « Anyone Else but you » et sa poésie légère signé The Moldy Peaches. Les acteurs principaux, Elliott Page et Michael Cera en feront d’ailleurs une repris, présente sur la dernière piste de l’album. Cette interprétation c’est aussi celle que l’on retrouve dans l’une des scènes du film, moment de complicité entre nos deux ados perdus. Un titre d’autant plus important que c’est l’acteur principal (qui n’avait pas encore fait son coming out trans à l’époque) qui suggère au réalisateur, Jason Reitman, d’utiliser ce titre pour personnifier les goûts musicaux de Juno. Toute la bande originale choisit le clair-obscur pour se faire inoubliable. Enfantin, « Vampire » de Antsy Pants, le groupe de Kimya Dawson, reste un temps fort d’un album qui s’écoute encore et encore pour y trouver une belle dose de candeur.
Eternal Sunshine of the Spotless Mind : se souvenir du soleil
 Aucun film n’a autant marqué et retourné avec une telle poésie qu' »Eternal Sunshine of the spotless mind ». L’objectivité est impossible face à l’immense œuvre de Michel Gondry puisque personne avant et après lui, n’a jamais aussi bien parlé de blessure amoureuse, de rupture, de fin. Kate Winsley et Jim Carrey y campent Clementine et Joel dont l’histoire d’amour touche à sa fin. Les douleurs sont là, les tumultes trop grands, trop forts. Alors il faut oublier. C’est ainsi que Clémentine d’abord puis Joel, décident d’utiliser un procédé qui permet d’effacer de sa mémoire l’être qui fut un temps aimé. Le film nous fait alors voyager dans l’esprit de Joel, en retournant image après image jusqu’au début de leur histoire. Pourtant au cours du « traitement » Joel, pris de remords ne veut plus oublier. Le voilà forcé à voir disparaitre les beaux moments qu’il chérissait et à tenter le tout pour le tout pour garder une trace de Clementine. Comme chaque bande originale qui fonctionne, le film est marqué par un titre inoubliable. Celui-ci n’est autre qu' »Everybody is gotta learn sometimes » de Beck. Il y signe une reprise à couper le souffle de The Korgis. Aussi dure, captivante et poétique que le film qu’il habille. Sortie le 16 mars 2004, cette soundtrack est composée à Los Angeles par Jon Brion et on y retrouve également, en quantité, Electric Light Orchestra. Toute la composition se base alors sur deux thèmes : la mémoire et le soleil. Jon Brion y compose majoritairement des titres instrumentaux. Il livre néanmoins un seul titre sur lequel il chante. Il s’agit du morceau « Strings that tie to you », à la douceur solaire rayonnante, fable musicale qui met l’accent sur ses rythmiques. Mais c’est surtout Electric Light Orchestra qui apporte son lot de joyeusetés à la galette. Notamment grâce à son titre culte « Mr Blue Sky » que l’on peut entendre sur les trailers du film ( mais pas dans le film lui-même). On y retrouve également les rockeurs de The Willowz habitués à Gondry puisqu’ils sont également aux crédits de la B.O de l’étrange « La science des rêves » du même réalisateur. A noter que le mélomane Gondry a choisi de distiller des références musicales dans son œuvre. Ainsi certains albums apparaissent et son mentionnés dans le films : celui de Brian Eno, « Music for airports », « Homogenic » de Björk et « Rain dogs » de Tom Wait. Prolongement d’une expérience hors-normes dont on ne se remet jamais, cette B.O replonge dans une œuvre sublime qui parle si fort au cœur qu’elle semble avoir été écrite pour vous.
Aucun film n’a autant marqué et retourné avec une telle poésie qu' »Eternal Sunshine of the spotless mind ». L’objectivité est impossible face à l’immense œuvre de Michel Gondry puisque personne avant et après lui, n’a jamais aussi bien parlé de blessure amoureuse, de rupture, de fin. Kate Winsley et Jim Carrey y campent Clementine et Joel dont l’histoire d’amour touche à sa fin. Les douleurs sont là, les tumultes trop grands, trop forts. Alors il faut oublier. C’est ainsi que Clémentine d’abord puis Joel, décident d’utiliser un procédé qui permet d’effacer de sa mémoire l’être qui fut un temps aimé. Le film nous fait alors voyager dans l’esprit de Joel, en retournant image après image jusqu’au début de leur histoire. Pourtant au cours du « traitement » Joel, pris de remords ne veut plus oublier. Le voilà forcé à voir disparaitre les beaux moments qu’il chérissait et à tenter le tout pour le tout pour garder une trace de Clementine. Comme chaque bande originale qui fonctionne, le film est marqué par un titre inoubliable. Celui-ci n’est autre qu' »Everybody is gotta learn sometimes » de Beck. Il y signe une reprise à couper le souffle de The Korgis. Aussi dure, captivante et poétique que le film qu’il habille. Sortie le 16 mars 2004, cette soundtrack est composée à Los Angeles par Jon Brion et on y retrouve également, en quantité, Electric Light Orchestra. Toute la composition se base alors sur deux thèmes : la mémoire et le soleil. Jon Brion y compose majoritairement des titres instrumentaux. Il livre néanmoins un seul titre sur lequel il chante. Il s’agit du morceau « Strings that tie to you », à la douceur solaire rayonnante, fable musicale qui met l’accent sur ses rythmiques. Mais c’est surtout Electric Light Orchestra qui apporte son lot de joyeusetés à la galette. Notamment grâce à son titre culte « Mr Blue Sky » que l’on peut entendre sur les trailers du film ( mais pas dans le film lui-même). On y retrouve également les rockeurs de The Willowz habitués à Gondry puisqu’ils sont également aux crédits de la B.O de l’étrange « La science des rêves » du même réalisateur. A noter que le mélomane Gondry a choisi de distiller des références musicales dans son œuvre. Ainsi certains albums apparaissent et son mentionnés dans le films : celui de Brian Eno, « Music for airports », « Homogenic » de Björk et « Rain dogs » de Tom Wait. Prolongement d’une expérience hors-normes dont on ne se remet jamais, cette B.O replonge dans une œuvre sublime qui parle si fort au cœur qu’elle semble avoir été écrite pour vous.
Drive : électro à 100 à l’heure
 Si « Drive » est aujourd’hui culte c’est en partie grâce à Ryan Gosling et en partie grâce à sa bande-originale. C’est d’abord Johnny Jewel qui est embauché pour créer les sonorités qui colleront le mieux à notre conducteur taiseux, maître de son volant et atout des grands criminels. Il fallait pour donner au film de Nicolas Widding Refn, des mélodies électros, abstraites, rétros, qui permettraient au spectateur de se plonger pleinement dans la psyché de « the driver ». Pour le réalisateur le film, il dépeint ici une sorte de conte de fée moderne et c’est pour cette raison qu’il choisit de faire figurer dessus certains titres comme « Under your spell » . La musique, tout comme dans « Baby Driver » sert profondément à illustrer le propos et à sublimer les actions. Ainsi lorsque le titre « A real hero » débute il est question de devenir un véritable humain et un véritable héros autant dans les paroles que dans le déroulé de l’intrigue. Les mélodies se veulent souvent relaxantes, rétro et europop à la mode 80’s. Finalement c’est Cliff Martinez qui est embauché en dernière minute et reprend le travail de Jewel. Le compositeur apporte énormément au film puisque c’est lui qui propose d’utiliser le titre « Nightcall » de Kavinsky dans la scène d’ouverture. Une excellente idée qui lie à jamais le morceau et le film. Présent sur l’album « OutRun », le titre est produit par Guy-Manuel de Daft Punk. Il se verra ensuite interprété en clôture des jeux Olympiques de Paris en 2024. Pour autant, nul doute qu’il sera à jamais vu comme un morceau sous adrénaline, porteur du film sorti en 2011, bijou culte d’ambiance et d’esthétisme.
Si « Drive » est aujourd’hui culte c’est en partie grâce à Ryan Gosling et en partie grâce à sa bande-originale. C’est d’abord Johnny Jewel qui est embauché pour créer les sonorités qui colleront le mieux à notre conducteur taiseux, maître de son volant et atout des grands criminels. Il fallait pour donner au film de Nicolas Widding Refn, des mélodies électros, abstraites, rétros, qui permettraient au spectateur de se plonger pleinement dans la psyché de « the driver ». Pour le réalisateur le film, il dépeint ici une sorte de conte de fée moderne et c’est pour cette raison qu’il choisit de faire figurer dessus certains titres comme « Under your spell » . La musique, tout comme dans « Baby Driver » sert profondément à illustrer le propos et à sublimer les actions. Ainsi lorsque le titre « A real hero » débute il est question de devenir un véritable humain et un véritable héros autant dans les paroles que dans le déroulé de l’intrigue. Les mélodies se veulent souvent relaxantes, rétro et europop à la mode 80’s. Finalement c’est Cliff Martinez qui est embauché en dernière minute et reprend le travail de Jewel. Le compositeur apporte énormément au film puisque c’est lui qui propose d’utiliser le titre « Nightcall » de Kavinsky dans la scène d’ouverture. Une excellente idée qui lie à jamais le morceau et le film. Présent sur l’album « OutRun », le titre est produit par Guy-Manuel de Daft Punk. Il se verra ensuite interprété en clôture des jeux Olympiques de Paris en 2024. Pour autant, nul doute qu’il sera à jamais vu comme un morceau sous adrénaline, porteur du film sorti en 2011, bijou culte d’ambiance et d’esthétisme.
Scream : la bande-originale qui place Nick Cave au pays des slashers
 Pionnier du grand retour des slashers en 1996, la saga Scream et son incroyable premier volet doit son succès à plusieurs facteurs. Déjà, la patte du duo Kevin Williamson / Wes Craven à l’écriture et à la réalisation, tandem aussi déluré qu’horrifique qui a su renouveler le genre. L’humour y côtoie le gore mais surtout un amour obsessionnel pour les références qui ont inspiré le film. « Halloween » en fait partie. On le sait, la saga qui met à l’honneur Michael Meyers doit beaucoup à son réalisateur également compositeur émérite : John Carpenter (le grand, l’immense, l’unique). Quand on pense Halloween, son thème musical vient, il faut l’avouer, immédiatement en tête. C’est surement lui qui aurait sa place dans un classement entièrement objectif des meilleures B.O. Mais la soundtrack de « Scream » a tellement marqué, au moins mon esprit qu’il aurait paru impensable de ne pas en parler. Marco Beltrami y signe le culte « Trouble in Woodsboro » et c’est déjà énorme ! Mais il faudra tout de même ajouter qu’on y retrouve « Red Right Hand » de Nick Cave, bien avant « Peaky Blinder », c’est donc à « Scream » qu’il faut l’associer. Le reste de la soundtrack est un condensé de tubes, parfois à l’énergie teen captivante comme Republica et son « Drop dead gorgeous » totalement badass ou encore Birdbrain et son intemporel « Youth of America » au début de la fête la plus sanglante du premier volet. On oublie pas Gus et son « Don’t fear the reaper » qui devait évidement y avoir une place centrale ( et s’utilise comme un spoiler dans une scène qui met Billy et Sidney à l’écran). Le second volet met à l’honneur le titre « I Think I love you » ( The Partridge Family) chanté en grande pompe par Dereck à Sidney en plein dans la cafétéria, puis au générique par Less Than Jake. Toujours profondément rock, à l’exception bien trouvé d’une incursion sur Moby en fin de bobine, les B.O des différents volets se font carrément metal dans le 3ème opus. On peut d’ailleurs y écouter le groupe de David Arquette (Dewey dans la saga), Hear 2000 entrevdeux titres de Creed. Des albums tranchants, au moins jusqu’au troisième opus.
Pionnier du grand retour des slashers en 1996, la saga Scream et son incroyable premier volet doit son succès à plusieurs facteurs. Déjà, la patte du duo Kevin Williamson / Wes Craven à l’écriture et à la réalisation, tandem aussi déluré qu’horrifique qui a su renouveler le genre. L’humour y côtoie le gore mais surtout un amour obsessionnel pour les références qui ont inspiré le film. « Halloween » en fait partie. On le sait, la saga qui met à l’honneur Michael Meyers doit beaucoup à son réalisateur également compositeur émérite : John Carpenter (le grand, l’immense, l’unique). Quand on pense Halloween, son thème musical vient, il faut l’avouer, immédiatement en tête. C’est surement lui qui aurait sa place dans un classement entièrement objectif des meilleures B.O. Mais la soundtrack de « Scream » a tellement marqué, au moins mon esprit qu’il aurait paru impensable de ne pas en parler. Marco Beltrami y signe le culte « Trouble in Woodsboro » et c’est déjà énorme ! Mais il faudra tout de même ajouter qu’on y retrouve « Red Right Hand » de Nick Cave, bien avant « Peaky Blinder », c’est donc à « Scream » qu’il faut l’associer. Le reste de la soundtrack est un condensé de tubes, parfois à l’énergie teen captivante comme Republica et son « Drop dead gorgeous » totalement badass ou encore Birdbrain et son intemporel « Youth of America » au début de la fête la plus sanglante du premier volet. On oublie pas Gus et son « Don’t fear the reaper » qui devait évidement y avoir une place centrale ( et s’utilise comme un spoiler dans une scène qui met Billy et Sidney à l’écran). Le second volet met à l’honneur le titre « I Think I love you » ( The Partridge Family) chanté en grande pompe par Dereck à Sidney en plein dans la cafétéria, puis au générique par Less Than Jake. Toujours profondément rock, à l’exception bien trouvé d’une incursion sur Moby en fin de bobine, les B.O des différents volets se font carrément metal dans le 3ème opus. On peut d’ailleurs y écouter le groupe de David Arquette (Dewey dans la saga), Hear 2000 entrevdeux titres de Creed. Des albums tranchants, au moins jusqu’au troisième opus.
The secret life of Walter Mitty : la bande originale pour rêver folk
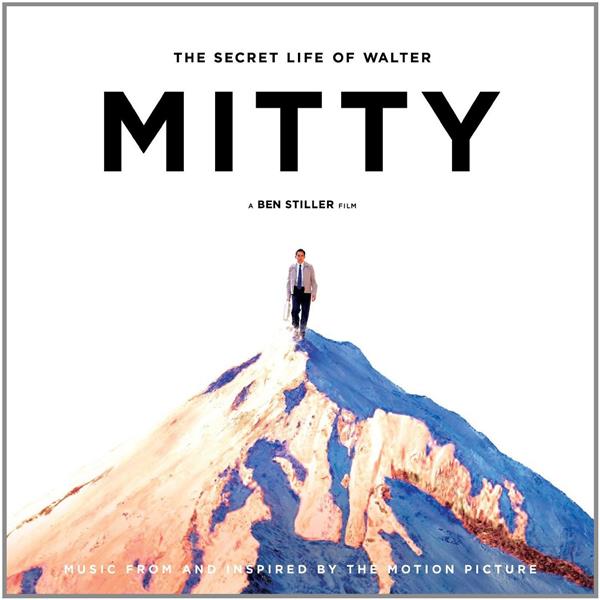 En 2013, Ben Stiller a la bonne idée de livrer sa version sur pellicule de « La Vie Secrète de Walter Mitty », un roman de James Thurber paru en 1939. On y suit les aventure de Walter, grand timide employé au service negatifs du magazine Life. Manquant souvent de courage, il vit de grandes aventure mais, seulement dans sa tête et n’ose confier ses sentiments amoureux à sa ollègues. Seulement voilà, un jour, un cliché égaré va le forcer à parcourir le monde, pour y vivre de véritables aventures aussi époustouflantes que grandioses. Au bout du chemin, il se trouvera lui-même (mais aussi Sean Penn et ça c’est pas rien). Pour coller à la grandeur du film, ses paysages épiques qui vont de l’Island à l’Afghanistan, sa narration magique, il fallait une soundtrack tout aussi grandiose. Et pour ça on peut évidemment compter sur José Gonzalez qui co-signe 12 titres sur la bande originale et qu’on retrouve trois fois sur la soundtrack. Impossible d’ailleurs de passer à côté de la merveille qu’est son « Stay Alive », ode à la vie, celle qui existe lors des chaudes nuits d’été et qui se prolonge comme un doux rêve. Le morceau prend d’ailleurs tout son sens lors d’une certaine scène de skate en Island et amène spectateur et personnage principal à voler dans les airs. Outre ce grand compositeur folk, Walter Mitty ne serait rien sans le titre de David Bowie « Space Oddity » utilisé dans la trame narrative du film. Kirsten Wiig en livre une version inoubliable. « Ground control to Major Tom » se décline ainsi musicalement comme dans les dialogues puisque souvent dans la Lune, Walter se fait constamment titiller sur le sujet. C’est probablement un périple jusqu’à la Lune auquel convoque cette bande originale époustouflante à la folk solaire. Impossible de se lasser de celles et ceux qui y ont leur place : Of Monsters and Men (et son « Dirty Paws »), Junip ( et l’excellence de « Far Away »), ou encore Jack Johnson (et le classique « Escape (The Pina colada song) »). Rien n’a été laissé au hasard par Ben Stiller, également à la production de la bande-sonore. Un moment d’évasion en musique, qui inspire autant l’envie de re(re) voir le film que d’aller au grand air vivre à pleins poumons.
En 2013, Ben Stiller a la bonne idée de livrer sa version sur pellicule de « La Vie Secrète de Walter Mitty », un roman de James Thurber paru en 1939. On y suit les aventure de Walter, grand timide employé au service negatifs du magazine Life. Manquant souvent de courage, il vit de grandes aventure mais, seulement dans sa tête et n’ose confier ses sentiments amoureux à sa ollègues. Seulement voilà, un jour, un cliché égaré va le forcer à parcourir le monde, pour y vivre de véritables aventures aussi époustouflantes que grandioses. Au bout du chemin, il se trouvera lui-même (mais aussi Sean Penn et ça c’est pas rien). Pour coller à la grandeur du film, ses paysages épiques qui vont de l’Island à l’Afghanistan, sa narration magique, il fallait une soundtrack tout aussi grandiose. Et pour ça on peut évidemment compter sur José Gonzalez qui co-signe 12 titres sur la bande originale et qu’on retrouve trois fois sur la soundtrack. Impossible d’ailleurs de passer à côté de la merveille qu’est son « Stay Alive », ode à la vie, celle qui existe lors des chaudes nuits d’été et qui se prolonge comme un doux rêve. Le morceau prend d’ailleurs tout son sens lors d’une certaine scène de skate en Island et amène spectateur et personnage principal à voler dans les airs. Outre ce grand compositeur folk, Walter Mitty ne serait rien sans le titre de David Bowie « Space Oddity » utilisé dans la trame narrative du film. Kirsten Wiig en livre une version inoubliable. « Ground control to Major Tom » se décline ainsi musicalement comme dans les dialogues puisque souvent dans la Lune, Walter se fait constamment titiller sur le sujet. C’est probablement un périple jusqu’à la Lune auquel convoque cette bande originale époustouflante à la folk solaire. Impossible de se lasser de celles et ceux qui y ont leur place : Of Monsters and Men (et son « Dirty Paws »), Junip ( et l’excellence de « Far Away »), ou encore Jack Johnson (et le classique « Escape (The Pina colada song) »). Rien n’a été laissé au hasard par Ben Stiller, également à la production de la bande-sonore. Un moment d’évasion en musique, qui inspire autant l’envie de re(re) voir le film que d’aller au grand air vivre à pleins poumons.
Almost Famous : FUN, drugs & rock’n’roll
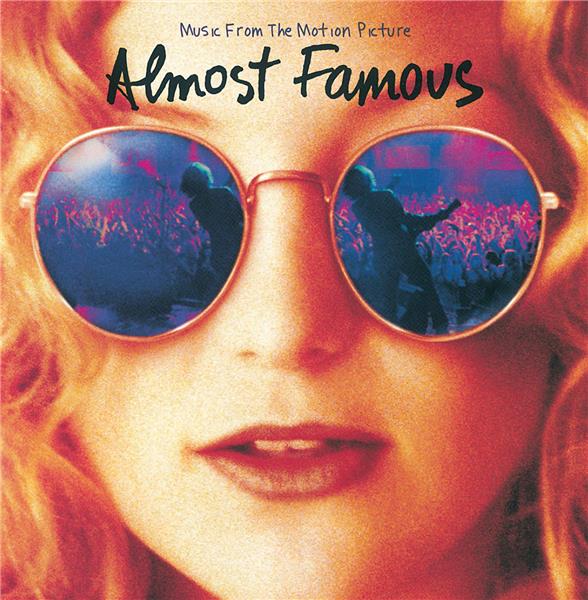 En 2000 sortait sans objectivité aucune, l’un des meilleurs films de tous les temps : « Almost Famous » ou « Presque Célèbre » en français. Cameron Crowe y suit le jeune William Miller, enfant sage et petit génie qui se retrouve embarqué dans la tournée du groupe de rock Stillwater en devenant apprenti journaliste pour Rolling Stones. Il y découvre l’envers du décors du monde du rock et prend part à cette folle vie de tour bus et de musique au milieu des groupeuses (et non pas des groupies comme elles le disent). « Presque Célèbre » est le film qui révèle au grand public Kate Hudson ( à l’époque elle était qualifiée par la presse d’actrice de l’année sur la jaquette du DVD). Trip épique au cœur du rock des années 70, le film n’a de cesse de faire références aux plus grands qui ont marqué, bien plus qu’une époque, mais des générations entières après eux. Il fallait donc une bande originale toute aussi puissante pour coller à cette œuvre. Et ça tombe bien puisque Crowe, lui-même fan de musique en profite pour créer une jolie pépite de rock, à tel point que cette soundtrack recevra en 2001 un Grammy pour sa qualité. Sur cette compilation, on retrouve notamment « Tiny Dancer » d’Elton John, dont le morceau donne naissance à l’un des plus beaux moment du film au cours d’une scène chantée dans le tour bus. Mais on retrouve aussi Simon & Garfunkel (« Allume une bougie en écoutant leur album et tu découvriras ton futur » disait d’ailleurs le personnage de Zooey Deschanel à son petit-frère William), The Who, The Beach Boys, Rod Stewart ou encore Yes. Led Zepplin, eux aussi présents, autorisèrent le réalisateur a utiliser leurs morceaux suite à un visionnage spécial qui fut fait pour Jimmy Page et Robert Plant. Néanmoins Crowe ne pu les convaincre de lui laisser utiliser « Stairway to heaven ». La soundtrack est même composée d’un titre du groupe inventé et vedette du film : Stillwater. Pour l’anecdote, Stillwater était également le nom d’un groupe existant et qui avait été signé sur Capricorn Records, ce qui força la production a obtenir l’autorisation d’appeler son groupe ainsi. Pour ce qui est de la création de leurs morceaux, c’est Cameron Crowe lui-même et son ex-femme, Nancy Wilson (de Heart) qui s’occupèrent de leur création. « Almost Famous » s’avère être un film très personnel pour Crowe puisque outre sa femme, le personnage de la mère de William fut inspiré par sa propre mère. Cette dernière était d’ailleurs présente sur le tournage du film. Ce qui explique sûrement pourquoi le film est une déclaration d’amour au rock, au monde de la musique, à celles et ceux qui le composent. De quoi vous donner envie de partir en tournée avec un groupe de rock et d’écouter fort les riffs de guitare de celles et ceux qui sont aujourd’hui très célèbres.
En 2000 sortait sans objectivité aucune, l’un des meilleurs films de tous les temps : « Almost Famous » ou « Presque Célèbre » en français. Cameron Crowe y suit le jeune William Miller, enfant sage et petit génie qui se retrouve embarqué dans la tournée du groupe de rock Stillwater en devenant apprenti journaliste pour Rolling Stones. Il y découvre l’envers du décors du monde du rock et prend part à cette folle vie de tour bus et de musique au milieu des groupeuses (et non pas des groupies comme elles le disent). « Presque Célèbre » est le film qui révèle au grand public Kate Hudson ( à l’époque elle était qualifiée par la presse d’actrice de l’année sur la jaquette du DVD). Trip épique au cœur du rock des années 70, le film n’a de cesse de faire références aux plus grands qui ont marqué, bien plus qu’une époque, mais des générations entières après eux. Il fallait donc une bande originale toute aussi puissante pour coller à cette œuvre. Et ça tombe bien puisque Crowe, lui-même fan de musique en profite pour créer une jolie pépite de rock, à tel point que cette soundtrack recevra en 2001 un Grammy pour sa qualité. Sur cette compilation, on retrouve notamment « Tiny Dancer » d’Elton John, dont le morceau donne naissance à l’un des plus beaux moment du film au cours d’une scène chantée dans le tour bus. Mais on retrouve aussi Simon & Garfunkel (« Allume une bougie en écoutant leur album et tu découvriras ton futur » disait d’ailleurs le personnage de Zooey Deschanel à son petit-frère William), The Who, The Beach Boys, Rod Stewart ou encore Yes. Led Zepplin, eux aussi présents, autorisèrent le réalisateur a utiliser leurs morceaux suite à un visionnage spécial qui fut fait pour Jimmy Page et Robert Plant. Néanmoins Crowe ne pu les convaincre de lui laisser utiliser « Stairway to heaven ». La soundtrack est même composée d’un titre du groupe inventé et vedette du film : Stillwater. Pour l’anecdote, Stillwater était également le nom d’un groupe existant et qui avait été signé sur Capricorn Records, ce qui força la production a obtenir l’autorisation d’appeler son groupe ainsi. Pour ce qui est de la création de leurs morceaux, c’est Cameron Crowe lui-même et son ex-femme, Nancy Wilson (de Heart) qui s’occupèrent de leur création. « Almost Famous » s’avère être un film très personnel pour Crowe puisque outre sa femme, le personnage de la mère de William fut inspiré par sa propre mère. Cette dernière était d’ailleurs présente sur le tournage du film. Ce qui explique sûrement pourquoi le film est une déclaration d’amour au rock, au monde de la musique, à celles et ceux qui le composent. De quoi vous donner envie de partir en tournée avec un groupe de rock et d’écouter fort les riffs de guitare de celles et ceux qui sont aujourd’hui très célèbres.
Good Morning England : radio rock
Difficile de parler de soundtacks marquantes sans parler de la plus britannique des comédies sur la musique ! Film culte pour les amateurs de rock, « The Boat that rocked » en V.O posait son ancre au cinéma en 2009. Son casting à lui seul avait de quoi laisser rêveurs : Philip Seymour Hoffman, Bill Nighy (le grand, l’unique), Nick Frost ou encore Rhys Ifans. Mais c’est surtout son sujet original et déluré qui en fait une œuvre culte ! La joyeuse bande est en effet embarquée sur les eaux internationales pour diffuser sa radio pirate. Nous sommes alors en 1966 et le gouvernement britannique de son côté est prêt à tout pour mettre un terme à ces fameuses radios et faire taire les groupes de rock et le bordel qu’ils créent. Sur le navire affaire de musique et affaires sentimentales se côtoient en un tourbillon aussi intense que de gros pogos. Evidemment, avec un sujet comme celui-ci, la bande son ne pouvait qu’être soignée. Et le résultat est là. On y retrouve Duffy, The Jeff Beck Group, The Troggs, The Who, The Jimi Hendrix Experience, The Kinks, The Turtles, David Bowie, The Melody Blues … La liste est vertigineuse et sans fin. D’ailleurs le titre de Bowie sera celui qui crée l’anachronisme mais on ne peut que pardonner la présence d’un tel monument dans cet univers. Machine à remonter le temps sonore, cette soundtrack se déguste comme la photographie d’une époque délurée. A écouter en boucle en se rappelant que les arts ne doivent jamais être tus.
8 Mile : La bande originale pour se raconter par le rap
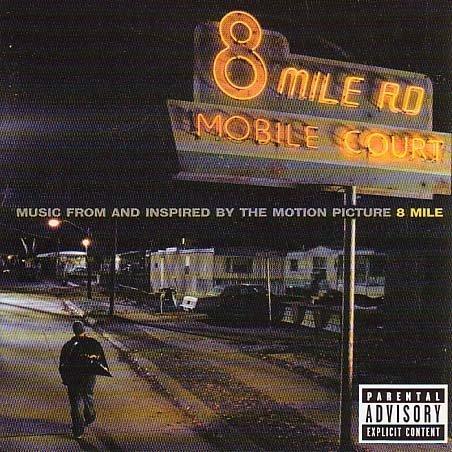 Quelques notes du morceau, extrêmement connu qu’est « Lose Yourself » et nous voilà plongés dans l’univers d’ « 8 Mile » ! Le film raconte une version romancée de la vie d’Eminem alors rappeur débutant. Ce morceau à lui seul justifierait un article tant sa qualité est indéniable. Aussi puissant qu’à fleur de peau, il permet à Eminem de se livrer une nouvelle fois, encore habité alors par la rage qui faisait ses meilleures compositions à ses débuts. A tel point qu’il reçoit l’Oscar de la meilleure chanson originale lors de sa sortie. Rien que ça ! Nous en sommes en 2002 lorsque le film de Curtis Hanson sort sur grand écran. A l’affiche on retrouve évidemment Eminem dans « son propre rôle » mais aussi Kim Basinger dans le rôle de la mère du rappeur et la regrettée Brittany Murphy. Le film raconte la vie de Jimmy « B-Rabbit » Smith Jr ( joué par Eminem), jeune homme déprimé habitant à Détroit, qui essaie de faire carrière dans la musique. « White trash » aux difficultés réelles, le film se concentre sur son travail, ses tentatives de s’en sortir mais surtout le monde des battles de rap dans lesquelles il finira par briller. Evidemment avec sa thématique et son personnage principal, l’excellence ne pouvait qu’être de mise tout au long de sa soundtrack. On retrouve aux crédits la fleur du hip hop de l’époque (qui plait toujours autant aujourd’hui) : Eminem évidemment en tête de liste mais aussi Macy Gray, Jay-Z, D12, Xzibit, Obie Trice, Nas ou encore Young Zee. Pépite culte à la qualité indéniable, profondément indémodable, « 8 Mile » ne lasse jamais et donne une dose de courage supplémentaire à quiconque l’écoute. Il sera facile de s’y perdre pour mieux s’y retrouver et finir par appuyer quelques fois sur repeat pour remettre « Lose Yourself ».
Quelques notes du morceau, extrêmement connu qu’est « Lose Yourself » et nous voilà plongés dans l’univers d’ « 8 Mile » ! Le film raconte une version romancée de la vie d’Eminem alors rappeur débutant. Ce morceau à lui seul justifierait un article tant sa qualité est indéniable. Aussi puissant qu’à fleur de peau, il permet à Eminem de se livrer une nouvelle fois, encore habité alors par la rage qui faisait ses meilleures compositions à ses débuts. A tel point qu’il reçoit l’Oscar de la meilleure chanson originale lors de sa sortie. Rien que ça ! Nous en sommes en 2002 lorsque le film de Curtis Hanson sort sur grand écran. A l’affiche on retrouve évidemment Eminem dans « son propre rôle » mais aussi Kim Basinger dans le rôle de la mère du rappeur et la regrettée Brittany Murphy. Le film raconte la vie de Jimmy « B-Rabbit » Smith Jr ( joué par Eminem), jeune homme déprimé habitant à Détroit, qui essaie de faire carrière dans la musique. « White trash » aux difficultés réelles, le film se concentre sur son travail, ses tentatives de s’en sortir mais surtout le monde des battles de rap dans lesquelles il finira par briller. Evidemment avec sa thématique et son personnage principal, l’excellence ne pouvait qu’être de mise tout au long de sa soundtrack. On retrouve aux crédits la fleur du hip hop de l’époque (qui plait toujours autant aujourd’hui) : Eminem évidemment en tête de liste mais aussi Macy Gray, Jay-Z, D12, Xzibit, Obie Trice, Nas ou encore Young Zee. Pépite culte à la qualité indéniable, profondément indémodable, « 8 Mile » ne lasse jamais et donne une dose de courage supplémentaire à quiconque l’écoute. Il sera facile de s’y perdre pour mieux s’y retrouver et finir par appuyer quelques fois sur repeat pour remettre « Lose Yourself ».
John Waters, Génie du Sale : Retour sur un cinéaste d’exception
John Waters, avec sa carrière aussi prolifique qu’audacieuse, incarne l’esprit rebelle le plus radical du…
Rock en Seine 2022 J-2 : Nick le parc de Saint-Cloud (report)
Une première journée intense et so british de passée au Parc de Saint-Cloud et voilà…
Lettre d’amour à la saga Scream en attendant le 5ème volet
Imaginez un peu. Nous sommes en 1996, une époque aujourd’hui jugée incroyablement cool par le…





